Algérie-France : dossier mémoriel, question migratoire, présidentielle… Pourquoi Macron hausse le ton
Depuis que le président français a évoqué le « système politico-militaire » algérien, les vieux démons qui hantent les relations entre les deux pays se sont réveillés. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il radicalement changé de discours sur l’Algérie ?

Le président français Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse à Alger, le 6 décembre 2017. © Bechir Ramzy/Anadolu Agency/AFP
En accusant les responsables algériens de vivre sur « la rente mémorielle » lors d’une rencontre, le 30 septembre à l’Elysée, avec des jeunes franco-algériens, Emmanuel Macron s’est attiré les foudres d’Alger, qui a réagi par un coup de semonce en décidant la fermeture de l’espace aérien aux avions militaires français.
Dans un contexte de pré-campagne électorale avec une extrême droite galopante, Emmanuel Macron fait-il le jeu du populisme ou « prend-il son risque » pour secouer l’État algérien ? Et faire avancer le dialogue sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, un projet dont le président français a fait l’un des défis de son quinquennat ? Alors que la fin du mandat approche, l’effet escompté est aux antipodes des attentes d’Emmanuel Macron.
Le dialogue mémoriel s’est mué en monologue, Abdelmadjid Chikhi, alter ego algérien de Benjamin Stora, chargé de rédiger un rapport sur la question, n’ayant pas montré de volonté d’échanger avec l’historien français. « Macron a pris des décisions fortes et courageuses, voulant mener un dialogue avec les autorités algériennes », fait-on valoir du côté de l’Élysée.
« Une forme d’exigence »
Bien s’informer, mieux décider
Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles
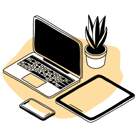
Les plus lus
- RDC : ce que l’on sait de la « tentative de coup d’État » déjouée à Kinshasa
- « France, dégage ! » Paris face au choc du souverainisme africain, par François Soudan
- Au Cameroun, comment les hommes de Paul Biya ont préparé (et verrouillé) le défilé du 20-Mai
- Entre Félix Tshisekedi et Apple, la bataille autour des « minerais du sang » prend une tournure judiciaire
- Bravador, l’influenceur ivoirien qui s’est mis au service d’Ousmane Sonko





