Crise anglophone au Cameroun : « L’État doit reconsidérer sa stratégie »
Au cœur du débat sur les moyens de sortir de la crise anglophone, Christian Pout, président du think tank CEIDES, appelle à mobiliser davantage les communautés locales pour trouver des solutions à la crise anglophone.

Manifestation à Kumba, après le massacre perpétré dans une école le 24 octobre 2020. © REUTERS/Josiane Kouagheu
Samedi 31 octobre était un jour de deuil national en mémoire des huit enfants tués par des individus non identifiés le 24 octobre dernier, à Kumba, dans la province anglophone du Sud-Ouest. Un drame de plus dans ce conflit armé qui oppose depuis bientôt quatre ans milices séparatistes et forces armées, mais dont le bilan humain reste difficile à chiffrer. En avril dernier, plus de 3 000 personnes avaient déjà perdu la vie, selon les Nations unies.
Alors que de nombreuses voies s’élèvent pour demander la fin des violences, Christian Pout, ministre plénipotentiaire, président du think tank Centre africain d’études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques (CEIDES) et directeur du Séminaire de géopolitique africaine à l’Institut catholique de Paris livre son analyse de la situation et plaide pour que l’État change sa stratégie face à cette crise et à ouvrir la porte au dialogue.

Christian Pout, ministre plénipotentiaire, est président du think tank Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques. © Franck Foute
Jeune Afrique : Bientôt quatre ans qu’un conflit armé secoue les régions anglophones du Cameroun. L’armée régulière peut-elle mettre fin aux violences ?
Christian Pout : L’option militaire n’a jamais été posée comme la solution. L’État s’est retrouvé face à des groupes dont les revendications étaient corporatistes et politiques et qui ont basculé dans la violence armée. Disposant de la violence physique légitime et de la capacité de contrainte, il a exercé ce pouvoir pour donner aux populations le moyen de vivre dans un environnement relativement sécurisé. Surtout que, en creux, planait une menace sur l’intégrité territoriale.
Ce qui a donné l’impression que la militarisation était choisie comme solution, c’est qu’il y a eu davantage d’investissements dans ce domaine. On a eu plusieurs changements : la création de la 5e région militaire, des nominations de hautes autorités de défense et de sécurité, un investissement dans la mobilisation de forces telles que le BIR [Bataillon d’intervention rapide], qui n’étaient pas présentes au début… Cela a donné le sentiment d’un surinvestissement dans l’option militaire, comme si elle devait être la seule à même de produire une solution.
Heureusement que d’autres mesures ont été prises. Des institutions ont été créées, notamment la commission du bilinguisme et du multiculturalisme.
Après les évènements de Kumba, certains appellent à un nouveau dialogue plus inclusif. Ce que demande également le secrétaire général de l’ONU. Cette proposition a-t-elle des chances d’aboutir ?
Bien s’informer, mieux décider
Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles
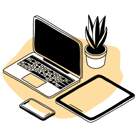
Les plus lus
- Au Burkina Faso, la confusion règne autour d’Ibrahim Traoré
- RDC : Félix Tshisekedi choisit son directeur de cabinet… dans son Église
- Au Sénégal, la nouvelle vie des ex-ministres de Macky Sall
- Présidentielle en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara met déjà son camp en ordre de bataille
- Reprise de Société générale Guinée : Mamadi Doumbouya mise sur Bank of Kigali






