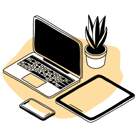Tunisie : enquête sur la stratégie mise en œuvre pour lutter contre le terrorisme
Le double attentat du 27 juin à Tunis témoigne, paradoxalement, du relatif affaiblissement des jihadistes. Quelle est la stratégie du gouvernement pour les annihiler ? Que doit-il encore améliorer ? Enquête.

Un militaire tunisien sur le lieu d’un attentat suicide en plein centre de Tunis, jeudi 27 juin 2019. © Riadh Dridi/AP/SIPA

La Tunisie face au terrorisme
La Tunisie a été frappée par plusieurs attentats et lutte contre des groupes armés et les trafics en tout genre à ses frontières. Depuis la révolution, le pays tente de restructurer et d’équiper ses services de la Défense et de l’Intérieur, à grands renforts de coopération internationale. Pour quels résultats ?
Un pick-up blanc criblé d’impacts, de la tôle froissée. Plus loin, des témoins décrivent avec effroi devant les caméras les morceaux de corps du kamikaze dispersés au sol, tandis que des bandes de signalisation circonscrivent les alentours. L’explosion a retenti en plein Tunis, ce 27 juin, avenue Charles-de-Gaulle, à quelques pas de l’entrée de la médina. Visé, un policier municipal a été tué.
Quelques minutes plus tard, un assaillant tente en vain de pénétrer au siège de la brigade antiterroriste, dans le quartier d’El Gorjani, avant de se faire exploser sur le parking. Dans le centre-ville, des passants se regroupent et crient : « Tunisie libre, terrorisme dégage ! » Si les cibles étaient sécuritaires, un civil a trouvé la mort, et d’autres font partie des 7 blessés.
Les images de ces attaques coordonnées rappellent un autre épisode, celui de la première tentative d’attentats simultanés, en partie déjoués, en octobre 2013, à Sousse et à Monastir. Là, le périmètre de sécurité laissait cruellement à désirer. De simples curieux s’étaient rapidement mêlés aux policiers, certains ramassant même des lambeaux de chair grillée du kamikaze. Fascination macabre ? Le contraste saisissant entre ces deux scènes illustre les progrès réalisés par les forces de sécurité tunisiennes.
Bien s’informer, mieux décider
Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles