Décès de Didier Ratsiraka : la dernière interview de l’ancien président malgache à Jeune Afrique
Ses débuts en politique, son engagement contre l’apartheid, ses relations avec Boumédiène, Houphouët-Boigny, Bongo ou encore Chirac… En avril 2020, l’ancien président malgache, décédé le 28 mars à Antananarivo, déroulait pour JA la bobine de ses souvenirs.

Didier Ratsiraka, l’ancien président malgache ici photographié en 2009, est décédé le 28 mars 2021 à Antananarivo. © REUTERS/Grant Lee Neuenburg
Celui qui a dirigé Madagascar par deux fois – de 1975 à 1993 puis de 1997 à 2002 – est décédé à l’âge de 84 ans dans la matinée de ce dimanche 28 mars à l’hôpital militaire de Soavinandriana, à Antananarivo, où il avait été admis le lundi 22. Didier Ratsiraka avait accordé un long entretien à Jeune Afrique en avril dernier, revenant sur ses souvenirs de militant anticolonialiste et d’homme d’État, que nous republions aujourd’hui.
Ce virus qui terrifie la planète ne semblait pas l’inquiéter outre mesure. Le 8 avril, il avait tout de même appelé ses compatriotes à la prudence, annonçant qu’il allait faire don de sa pension d’ancien chef de l’État (1 000 dollars mensuels) au système de santé malgache.
Mais sinon, on ne le voyait plus beaucoup. Président à deux reprises, de 1975 à 1993 et de 1997 à 2002, puis de nouveau candidat à la magistrature suprême en 2018, il vivait, de fait, en quasi confinement depuis de longs mois, entouré de quelques proches, dans sa résidence de Mangarivotra. Mis à sa disposition par l’État malgache en 2014, l’endroit domine Antananarivo. Il est aussi situé à quelques centaines de mètres seulement du domicile de Marc Ravalomanana, l’homme qui l’avait contraint à quitter le pouvoir il y a presque vingt ans.
C’est là qu’il avait reçu Jeune Afrique, bien avant que le coronavirus ne cloue au sol appareils, politiques et journalistes. Coupe de cheveux impeccable, élégant dans son costume trois-pièces de bonne coupe, arborant toujours ses fameuses bagues de jaspe et d’onyx au doigt, il avait posé une seule condition : il ne souhaitait pas parler de l’actualité.
Nous voici donc dans la petite pièce épurée qui lui servait de bureau. L’œil avait certes perdu de son acuité, mais la voix demeurait chaude. Les idées et la mémoire, surtout, restaient claires. Des cinq téléphones portables posés devant lui, pas un ne sonnera durant la longue interview qu’il nous accordera.
Pour J.A., cet homme qui fut un acteur et un témoin privilégié de l’Histoire de Madagascar et du continent pendant près de six décennies, avait accepté de dérouler la bobine de ses souvenirs. Et si l’on tendait bien l’oreille, on pouvait sans doute l’entendre fredonner « Non, je ne regrette rien », le tube d’Édith Piaf qu’il avait entonné sur le tarmac de l’aéroport d’Ivato à son retour d’exil en 2011.
Jeune Afrique : Madagascar s’apprête à fêter le 60e anniversaire de son indépendance. Comment le jeune Didier Ratsiraka a-t-il vécu le 26 juin 1960 ?
Didier Ratsiraka : Avec un passeport français et un uniforme français, puisque à l’époque je venais d’intégrer l’École navale de Brest. J’étais bien entendu pour l’indépendance et pour que mon pays prenne son destin en main, mais j’étais totalement impliqué dans mes études.
Deux ans plus tôt en revanche, en 1958, je m’étais opposé à ce que Madagascar rejoigne la Communauté française que nous proposait le général de Gaulle. Étudiant en classes préparatoires au lycée Henri-IV, à Paris, j’avais cumulé les petits boulots pour pouvoir me payer un aller-retour à Madagascar et voter non au référendum. Ce que j’ai fait.
Les Malgaches comme moi devaient se contenter d’un bol de riz, agrémenté d’un peu de sucre roux, quand les Français avaient droit à du café et des tartines beurrées
Comment est né votre anticolonialisme ?
Il date de mes années au collège Saint-Michel, à Antananarivo. Les Malgaches comme moi devaient se contenter d’un bol de riz, agrémenté d’un peu de sucre roux, quand les Français avaient droit à du café et des tartines beurrées. J’ai organisé la première grève de l’histoire de cet établissement, jusqu’à ce que nous soyons tous mis au même régime. Nous étions en 1953, c’était l’année où les Français commençaient à occuper Diên Biên Phu, en Indochine ; l’année suivante, Mohammed V, le roi du Maroc, arrivait en exil à Antsirabe. Moulay El Hassan, le futur Hassan II, était dans la classe de mon frère tandis que Moulay Abdallah, son cadet, était dans la mienne. Tout cela n’a fait que renforcer mes convictions.
Sentant mon malaise, et en dépit du fait que nous avions peu d’argent, mon père a décidé de m’envoyer poursuivre mes études en France. J’ai quitté Madagascar en 1955 à bord du Pierre-Loti, via Djibouti et Alexandrie, et j’ai débarqué un mois plus tard à Marseille. C’est là que j’ai fait la connaissance du Djiboutien Hassan Gouled Aptidon, qui était alors député pour la Côte française des Somalis. « Tu as bien grandi, Didier », me dira-t-il vingt ans plus tard, quand nous serons présidents de nos pays respectifs.
Bien s’informer, mieux décider
Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles
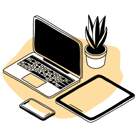
Les plus lus
- Cyril Ramaphosa réélu président grâce à un accord entre l’ANC et la DA
- Au Burkina Faso, la confusion règne autour d’Ibrahim Traoré
- Hajj 2024 : des millions de pèlerins et des milliards de dollars de bénéfice
- Au Sénégal, la nouvelle vie des ex-ministres de Macky Sall
- Comment expliquer le « vote xénophobe » des Français d’Afrique ?






