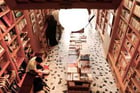Des Américains dans la cité : le « golden age » de Tanger
Le 30 avril 2024, l’Unesco a choisi Tanger comme ville-hôte mondiale de sa Journée internationale du jazz. Pour comprendre le lien entre ce genre musical afro-américain né dans le sud des États-Unis et la ville du détroit, un rappel historique s’impose.

Le compositeur suédois Magnus Lindgren, le saxophoniste américain Lakecia Benjamin, le saxophoniste américain Jaleel Shaw et le saxophoniste australien Troy Roberts se produisent lors de la journée internationale du jazz 2024, à Tanger © DR
Tanger, ancienne capitale diplomatique du Maroc et ancienne ville internationale pendant trente-trois ans a accueilli fin avril la Journée internationale du jazz, dont l’ambassadeur n’est autre que le légendaire musicien Herbie Hancock. Lequel n’a pas manqué, pour l’occasion, de souligner l’influence de Randy Weston sur son propre répertoire musical.
Randy Weston n’est pas aussi connu du grand public que d’autres grands jazzmen, mais c’est lui qui fait le lien entre ce genre musical et le Maroc, et plus précisément Tanger. C’est en 1967 que cet artiste originaire de Brooklyn découvre le royaume, lors d’une tournée organisée par le Département d’État américain au Maroc. Le coup de foudre pour la ville de Tanger est immédiat et il décide d’y poser ses valises pour quelques années. Jusqu’en 1972 pour être précis.
Durant son séjour, il découvre la musique gnaoua, un style musical harmonisant des musiques d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne. Pour Weston, il s’agit du chaînon manquant entre la musique africaine et le jazz. De cette sonorité, il va sortir un album qu’il intitule le plus simplement du monde Tanjah. Le succès est au rendez-vous : le disque est nommé en 1973 aux Grammy Awards dans la section « jazz performance by a big band ».
Tout ceci étant précisé, encore faut-il comprendre pourquoi les Américains avaient, dans les années 1960, opté pour la ville du détroit. Ce qui revient, en fait, à raconter l’histoire de « Tanger-l’Américaine ». Cette proximité ancienne, le visiteur la ressent d’abord quand il découvre pour la première fois le bâtiment en stuc de style néo-mauresque abritant la légation américaine de Tanger depuis 1821. Enfoui dans les dédales de la médina, l’immeuble a été gracieusement offert à Washington par le Sultan Moulay Slimane en signé d’amitié, suite à la signature du traité américano-marocain de 1788.
Mais c’est surtout à l’occasion de la seconde Guerre mondiale que les Américains vont se familiariser avec Tanger. Dès 1942, dans le cadre de l’opération Torch, les alliés prennent possession du pays, contrôlé jusqu’alors par la France vichyste, et que les échanges culturels commencent. Car les Marocains, eux aussi, s’initient à la culture américaine.
Déroulons maintenant la chronologie et remontons à l’après seconde Guerre mondiale. La guerre, malgré ses atrocités inhérentes, est un espace d’échange culturel. C’est en novembre 1942 à l’occasion de l’opération Torch visant à l’invasion de l’Afrique du Nord occupée par la France vichyste, et en prévision du débarquement de juin 1944 que les Américains découvrent le Maroc et que se révèle aux Marocains la culture américaine.
Après Paul Bowles, les Beat writers
Parmi les artisans de ce rapprochement, difficile de ne pas citer l’écrivain new-yorkais Paul Bowles. Celui-ci connaît la cité du détroit depuis la fin des années 1930, s’intéresse au folklore et à la musique marocaine. Il y élit domicile en 1949 et se lie d’amitié avec un panel d’écrivains tangérois qui racontent le quotidien de la ville. Des thèmes sociaux qu’il reprend dans ses romans et ses « short stories », devenant un passeur culturel de la première heure. Ses écrits, diffusés aux États-Unis, vont susciter soudainement l’intérêt pour Tanger, surtout dans les cercles littéraires de la Big Apple.
C’est ainsi que les auteurs les plus emblématiques de la Beat Generation débarquent à leur tour dans la cité portuaire. « D’autres Américains les ont précédés dans la ville blanche et leur font parvenir des échos tangérois, parfums de menthe fraîche, de citron, de kif, parfums d’aventure : Jane et Paul Bowles, bien sûr, mais aussi William Seward Burroughs que Ginsberg et Kerouac ont rencontré aux États-Unis en 1944 », précise la journaliste Christine Bahari.
L’occasion de préciser que le terme « beat » employé pour qualifier ces auteurs est polysémique : il renvoie à la fois à un rythme de musique enfiévrée, à la béatitude et enfin au fait d’être vaincu. Les beat writers ont hérité du pessimisme de leurs prédécesseurs, cette « lost generation » qui comptait dans ses rangs Ernest Hemingway, John Steinbeck ou John Dos Passos…
C’est bien sûr le Sur la route de Jack Kerouac qui fait figure de manifeste doctrinaire du mouvement beat, mais si ce groupe d’écrivain a marqué les mémoires par sa quête, très américaine, d’un nouveau far-west, d’une nouvelle frontière, leurs pas les ont aussi portés jusqu’à Tanger, où ils semblent – de Tennessee Williams à Brion Gysin ou Allan Ginsberg – avoir retrouvé cette atmosphère de liberté créatrice qu’ils n’ont cessé de rechercher.
Plus que quiconque, c’est le poète William Burroughs dans son Festin Nu, qui exprime cette quête et cette vie de bohême. « J’étais parvenu au terminus de la came quand j’ai entendu parler de ce vaccin, écrit-il. Je vivais alors dans un taudis du quartier indigène de Tanger. Depuis plus d’un an je n’avais pas pris de bain ni changé de vêtements. Je ne me déshabillais même plus – sauf pour planter, toutes les heures, l’aiguille d’une seringue hypodermique dans ma chair grise et fibreuse, la chair de bois du stade final de la drogue. Je n’avais jamais balayé ni rangé ma chambre. »
Brion Gysin, quant à lui, concomitamment à sa production artistique, va jusqu’à ouvrir un restaurant, « Les Mille et une nuits « . Un nom emblématique de la vision exotique que ces auteurs américains portent sur ce coin du monde oriental qu’est, pour eux, Tanger. C’est derrière les murs de cet établissement que les Rolling Stones découvriront la musique Jajouka, dont Burroughs qualifiait ceux qui la jouent de « groupe de rock vieux de plus de 4000 ans ».
La présence américaine à Tanger, toutefois, ne se limite pas à celle d’artistes plus ou moins marginaux ou maudits. D’autres citoyens des États-Unis autrement plus fortunés s’y sont aussi établis : Ion Perdicaris, Barbara Hutton et Malcom Forbes. Le premier est un dandy gréco-américain issu d’une famille très aisée des États du Sud, ayant fait fortune dans le gaz d’éclairage, la Trenton Gas Light Company. Un parc naturel, dans la Vieille Montagne, porte aujourd’hui son nom.
Les milliardaires et leurs fêtes mémorables
Milliardaire elle aussi, Barbara Hutton est la petite fille du fondateur new-yorkais des magasins Woolworth. En 1946, la « poor little rich girl », comme aimaient la surnommer les médias américains, acquiert une demeure dans la Kasbah, près du mausolée de Sidi Hosni. Un lieu resté célèbre pour les frasques de sa propriétaire, notamment ses légendaires bals masqués immortalisés dans Deux tickets pour Tanger, un roman à l’eau de rose de l’écrivain Francis Van Wick Mason.
Malcolm Forbes, magnat new-yorkais de la presse et fondateur du magazine qui porte son nom, s’installe quant à lui au Palais du Mendoub – le représentant du sultan sous le mandat international – dont il fait sa demeure. C’est en 1989 qu’il va marquer définitivement les mémoires tangéroises en organisant, pour son soixante-dixième anniversaire, une fête dont on parle encore. Six cents invités parmi lesquels l’actrice Elizabeth Taylor ou le secrétaire d’État Henry Kissinger, transportés depuis les États-Unis à bord de trois avions : un Concorde, un DC8 et un Boeing 747. La démesure festive est à l’égal de la fortune du milliardaire. « Alors que le soleil se couchait sur le palais Forbes, les convives de son 70e anniversaire peu à peu arrivaient (…) ils étaient quelque peu abasourdis. Sur les bords de la route, des centaines de Marocains portant des djellabas blanches et dansaient sur place pour les accueillir. Il y avait également des danseuses du ventre, des joueurs de bendir, de nefar et de ghaita (…) le ramdam pouvait être entendu depuis Gibraltar », écrit l’envoyée spéciale du Washington Post.
Un golden age américano-tangérois dont la récente Journée internationale du jazz n’a sans doute que tenté de se faire l’écho.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Cyril Ramaphosa réélu président grâce à un accord entre l’ANC et la DA
- Au Burkina Faso, la confusion règne autour d’Ibrahim Traoré
- Hajj 2024 : des millions de pèlerins et des milliards de dollars de bénéfice
- Au Sénégal, la nouvelle vie des ex-ministres de Macky Sall
- Comment expliquer le « vote xénophobe » des Français d’Afrique ?