Iran – Clément Therme : « Avec la mort du général Soleimani, Trump recrédibilise Téhéran »
L’assassinat le 3 janvier à Bagdad par les États-Unis du chef de la Force Al-Qods fait craindre un nouveau conflit armé dans la région. Les États-Unis endossent et normalisent le rôle de puissance étrangère prompte à l’ingérence que leur assigne la propagande iranienne.

Des manifestants à Téhéran le 4 janvier 2020, après le raid américain qui a tué Qassem Soleimani. © Ebrahim Noroozi/AP/Sipa
Il incarnait l’influence régionale de Téhéran dans le monde arabe, où il a tour à tour sauvé le régime Assad, musclé la rébellion houthie au Yémen et contribué à éliminer Daesh en l’Irak.
Figure controversée – artisan de la lutte contre le jihadisme ou criminel de guerre, selon les points de vue –, Qassem Soleimani a été exécuté par un missile tiré depuis un drone américain. Sa mort porte un coup dur à la République islamique, qui a déjà lancé la riposte.
Mais pourra-t-elle poursuivre l’escalade avec les États-Unis ? Éléments de réponse avec Clément Therme, chercheur post-doctorant pour l’équipe du Ceri Sciences-Po Paris.
Soleimani était central dans la stratégie de communication à destination du public iranien
Jeune Afrique : Quelle était l’importance réelle de Qassem Soleimani pour le régime iranien ?
Clément Therme : Qassem Soleimani était un militaire, un exécutant, mais pas un décisionnaire du système théocratique iranien. Il était certes important, puisqu’il était chargé de la mise en œuvre des lignes politiques décidées par le Guide suprême, Khamenei, mais son principal fait d’armes, du point de vue de l’opinion publique iranienne, c’est la lutte contre Daesh entre 2014 et 2017. Soleimani était donc central dans la stratégie de communication à destination du public iranien et dans le discours sur la stabilité autoritaire.
La mobilisation en son hommage en Iran, même si elle est à étudier avec beaucoup de précaution, montre qu’il existe une peur existentielle face à la politique américaine. La crainte d’un effondrement économique et politique a provoqué un sursaut de cohésion nationale.
La mort de Qassem Soleimani et l’escalade militaire qu’elle a engendrée ont fait chuter la Bourse de Téhéran, ce qui est une mauvaise nouvelle pour l’économie iranienne. Sa disparition a créé une incertitude sur l’intensité de la confrontation militaire et sur ses conséquences régionales.
L’objectif de la République islamique est de briser ce qu’elle appelle « l’encerclement » américain
Du point de vue de la société iranienne, était-il le héros décrit ?
Il était présenté comme le garant de la préservation de la sécurité nationale face à Daesh. D’un autre côté, il est le visage d’une politique régionale très impopulaire en Iran en raison de la non-prise en compte des revendications économiques des citoyens, notamment des classes populaires, et de l’incapacité de la République islamique à traiter ces demandes, à transformer l’Iran en pays normal.
Certes, on répond sur le plan rhétorique à la demande de stabilité des Iraniens, mais au prix du développement économique. Durant les vingt ans où Soleimani a dirigé la force Al-Qods, Téhéran a été incapable de concilier développement et stabilisation, sauf dans la courte période qui a suivi l’accord sur le nucléaire iranien, de 2015 et 2017.
Mais l’avènement de l’administration Trump a montré les limites de la stratégie du président Rohani. L’engagement iranien à l’extérieur a été un obstacle au développement à l’intérieur.

Lors des funérailles du général Qassem Soleimani, un drapeau américain brûle, le 4 janvier 2020 à Baghdad, en Irak. © Nasser Nasser/AP/Sipa
Que change sa mort à l’influence iranienne dans le monde arabe ?
À court terme, cela permet à l’Iran de capitaliser sur le sentiment antiaméricain en Irak. Le non-respect de la souveraineté d’un État rappelle les stratégies de changement de régime. Ce sont des méthodes illégales sur le plan du droit international, et cela contribue à normaliser l’attitude de la République islamique, qui peut accuser l’Amérique d’ingérence.
Sa mort permet ainsi de détourner l’attention de l’ingérence iranienne chez ses voisins. Il sera beaucoup plus difficile pour les forces politiques irakiennes de revendiquer publiquement leur intention de travailler avec les autorités américaines.
L’objectif de la République islamique est de créer une atmosphère psychologique défavorable au maintien de la présence militaire des États-Unis, et de briser ce qu’elle appelle « l’encerclement » américain. La violation du droit international par Trump recrédibilise l’Iran, parce qu’elle déconstruit la critique occidentale contre la République islamique. Et, en ce sens, le soutien qu’apporte la France à cette exécution extrajudiciaire est assez intéressant.
Avec l’alignement européen sur les États-Unis et la reprise de son programme nucléaire, l’Iran dépend plus que jamais de la Russie et de la Chine
L’Iran connaît des contestations populaires récurrentes. La mort de Soleimani peut-elle ressouder les Iraniens derrière le pouvoir ?
Il y a une cohésion au sein des différentes factions iraniennes, des modérés aux conservateurs. Mais le changement à la tête de la force Al-Qods ne modifie pas la stratégie du tout-sécuritaire du régime islamique, laquelle compromet l’avenir économique du pays. L’internationalisme islamique porté par l’Iran khomeyniste se heurte aujourd’hui à la résilience des nationalismes séculiers, qui s’expriment dans la rue dans l’ensemble du Moyen-Orient.
On voit même une convergence de solidarité entre l’Iran, l’Irak et le Liban, où les populations ont les mêmes revendications sur la transparence et la lutte contre la corruption. Nous sommes aujourd’hui dans le temps géopolitique, pas dans le temps social, mais ce dernier va resurgir. Sauf en cas de guerre : c’est alors la peur de la destruction de l’Iran qui dominera.
La riposte iranienne – pour le moment des tirs de missiles contre des bases militaires en Irak – peut-elle aller plus loin ?
Il y a quatre piliers de la doctrine iranienne pour la « défense offensive » : la réponse asymétrique, les cyberattaques, l’utilisation de drones et de missiles balistiques, comme on l’a vu contre la Saudi Aramco et lors de la riposte militaire iranienne contre deux bases militaires en Irak, et la guérilla maritime.
Pour cette dernière, c’est devenu plus compliqué, parce que la Chine, l’un des principaux pays importateurs de pétrole, est favorable à la liberté de circulation. Et Pékin est un partenaire stratégique dont dépend largement la survie économique de l’Iran.
Avec l’alignement européen sur les États-Unis et la reprise de son programme nucléaire, l’Iran dépend plus que jamais de la Russie et de la Chine. Ce seront les deux principales puissances qui vont pouvoir exercer une influence modératrice sur l’escalade militaire irano-américaine.
Moscou et Pékin ont intérêt à préserver l’intégrité du détroit d’Ormuz, et, s’agissant de la Russie, à protéger son partenariat avec la Turquie. Ce sont des États favorables au statu quo, même s’ils sont satisfaits de l’accroissement des tensions avec les États-Unis puisque cela leur permet de se poser en puissances pacifiques et médiatrices.
L’Iran et ses rivaux, dirigé par Clément Therme, Passés Composés, février 2020.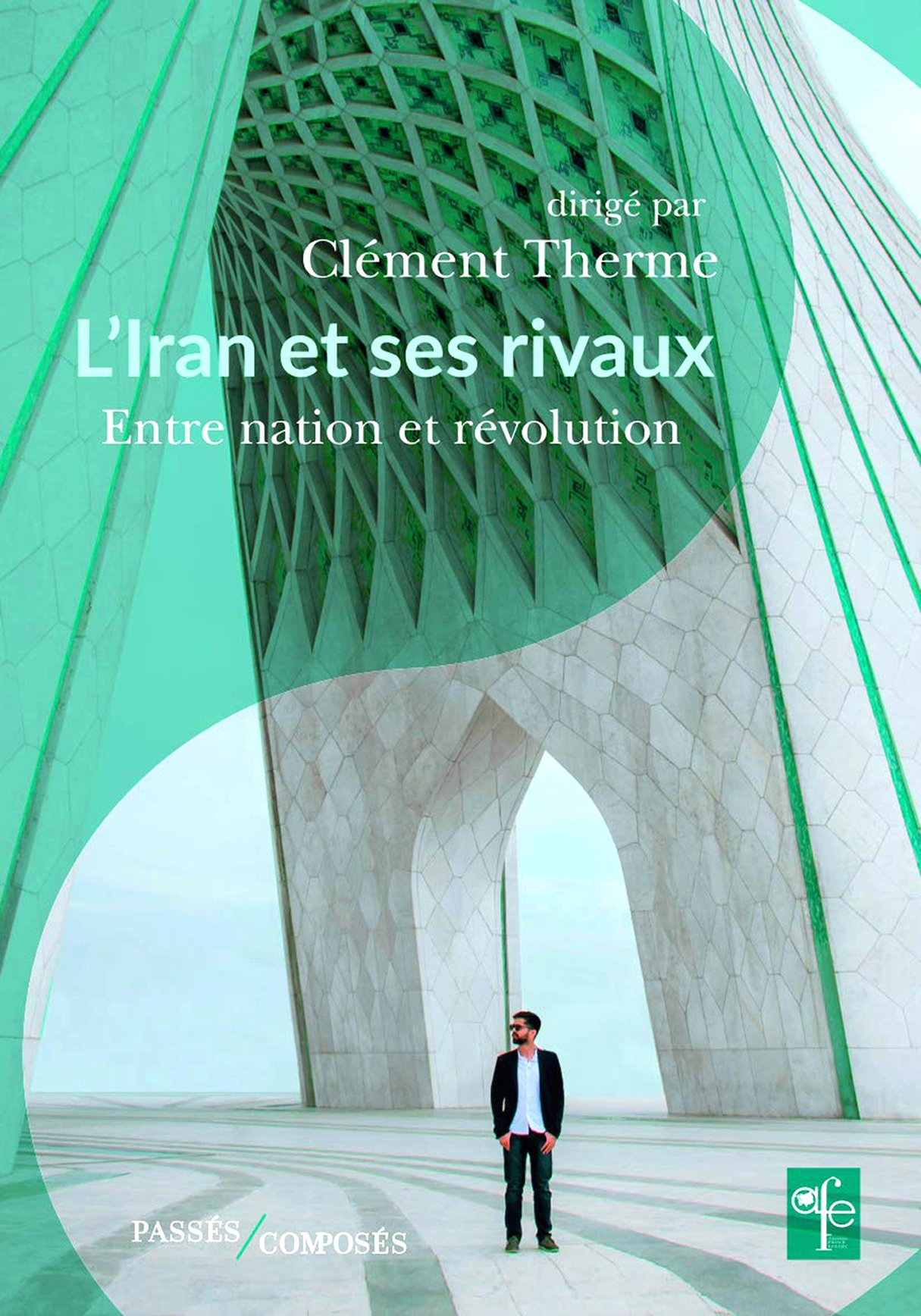
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
