Libye : comment les mercenaires du maréchal Haftar ont sombré… dans le ridicule
Un rapport de l’ONU révèle les dessous d’une opération « pieds nickelés » de recrutement de mercenaires par Haftar. Et lève le voile au passage sur des circuits de financement occultes.

Le maréchal Haftar en conférence de presse. © SIPA
L’histoire pourrait faire rire, si elle n’illustrait pas, et de manière dramatique, à quel point la Libye a sombré dans un univers kafkaïen où le tragique le dispute à l’absurde. Elle est révélée par nos confrères du New York Times, qui ont mis la main sur un rapport secret des Nations unies daté de février 2020, confirmant l’engagement de mercenaires dans le conflit libyen, et les obscurs circuits de financement de ces combattants étrangers.
En juin 2019, un commando mené par un ancien militaire britannique débarque dans le port de Benghazi, dans l’Est libyen, à bord de pneumatiques de combats. L’équipe est complétée par un second arrivage, depuis la Jordanie, de combattants de fortune originaires d’Afrique du Sud, d’Australie, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans le même temps, six hélicoptères atterrissent, à Benghazi toujours. Leur plan de vol initial prévoyait de rallier la Jordanie depuis le Botswana. Officiellement, la vingtaine d’hommes débarquée à Benghazi est chargée de « sécuriser des installations pétrolières et de gaz ».
80 millions de dollars
En réalité, tous sont là pour une mission militaire de courte durée, engagés par le maréchal Khalifa Haftar, pour la coquette somme de 80 millions de dollars, afin de l’épauler dans son assaut final contre la capitale Tripoli. Quatre jours après le débarquement du commando, le marché tombe à l’eau. Haftar se plaint de la vétusté des hélicoptères, non conformes à sa commande. Selon les documents obtenus par les Nations unies, le chef de guerre aurait dû recevoir un hélicoptère d’attaque Cobra et un LASA T-Bird, qui sert notamment aux missions de reconnaissance. Une dispute éclate. Et dans la nuit du 2 juillet, la milice remet le cap sur Malte, à bord de ses vedettes militaires. « Mission bâclée », commente le New York Times.
Composé d’anciens militaires, le commando comprend onze Sud-africains, cinq Britanniques, deux Australiens et un pilote américain
Bien s’informer, mieux décider
Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles
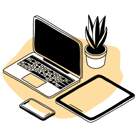
Les plus lus – Politique
- Paul Biya à Genève : ces privilégiés qui ont eu accès au chef
- Enquête sur Teodorín Obiang, l’implacable héritier de Malabo
- Au Niger, Al-Qaïda affirme avoir frappé aux portes de Niamey
- Sénégal : comment Ousmane Sonko et Pastef ont révolutionné le financement en polit...
- Longuè Longuè, torturé au Cameroun : « Dès mon arrivée à la Semil, ça a été un car...




