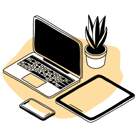Lutte antiterroriste en Tunisie : avec les chasseurs de mines de Bizerte
Pour désamorcer les engins explosifs disséminés par les groupes terroristes dans l’Ouest, le pays s’est doté d’un centre d’excellence. Nous l’avons visité, en exclusivité.

À Bizerte, exercice de sondage, à la recherche d’engins explosifs. © photos : Ons Abid pour ja

La Tunisie face au terrorisme
La Tunisie a été frappée par plusieurs attentats et lutte contre des groupes armés et les trafics en tout genre à ses frontières. Depuis la révolution, le pays tente de restructurer et d’équiper ses services de la Défense et de l’Intérieur, à grands renforts de coopération internationale. Pour quels résultats ?
Son pied s’abat lourdement sur la terre. Un son aigu retentit. « Vous voyez, là, ça sonne, relève le colonel Ahmed Ben Abdallah dans un demi-sourire. Dans la réalité, ça aurait explosé. » Bienvenue dans la routine mordante de l’équipe de déminage du 61e génie tunisien ! Sa base, dans la région de Bizerte (Nord), accueille depuis juin 2015 le premier centre d’excellence de lutte contre les mines et engins explosifs improvisés (IED). Huit cents soldats y ont déjà été formés.
Derrière le colonel de 46 ans qui dirige cette structure militaire ultraspécialisée : ciel bleu et champs d’oliviers. Ici, tout est contraste. La vue plonge au loin sur la plénitude du lac de Bizerte, dont le chenal se jette en Méditerranée. Sans un bruit, une colonne d’hommes kaki se plaquent au sol. À sa tête, un jeune lieutenant plante un drapeau de signalisation orange et sonde la terre. Sa vie tient à la précision de ses gestes. « En levant le poing, il stoppe toute une compagnie. Dans quelques semaines, il sera sur le terrain », souligne son supérieur.
Réalités du terrain
« Mon colonel, nous avons détecté un camp terroriste derrière ces buissons après avoir clarifié la route et sécurisé la zone, l’aviation nous appuie », rapporte le lieutenant. Le scénario est censé se dérouler sur le mont Salloum, à proximité du massif de Chaambi, près de la frontière algérienne. Deux groupes armés y sévissent : la katiba Okba Ibn Nafaa, affiliée à Al-Qaïda, et Jund al-Khilafa, proche de Daesh.
Âgé de 26 ans, le lieutenant a déjà passé deux ans dans la région, près de Kasserine. La « zone rouge » dans le jargon militaire. Jusque-là « homme de fouilles » muni d’un simple détecteur, il s’apprête à devenir « opérateur », un artificier démineur apte à manipuler et neutraliser tout type d’IED. « C’est nécessaire d’apprendre la technique et d’acquérir de la confiance », lâche-t-il.
Bien s’informer, mieux décider
Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles